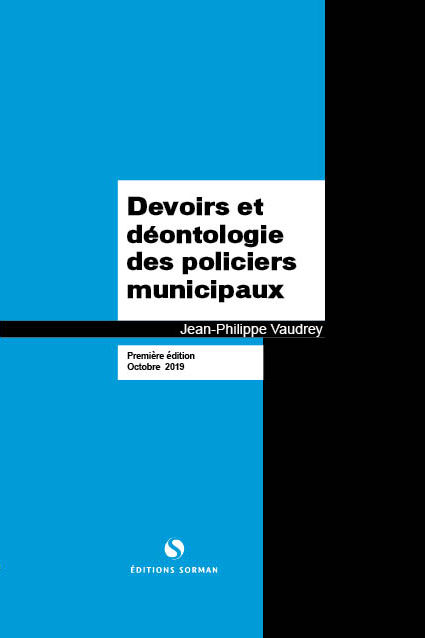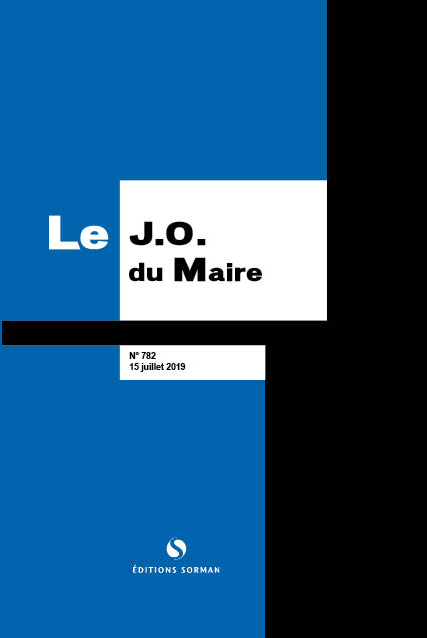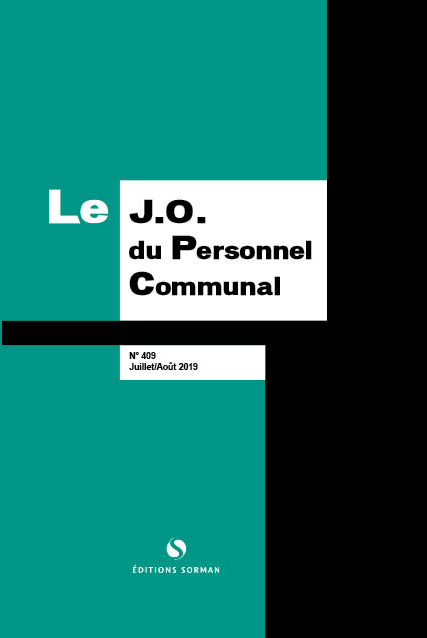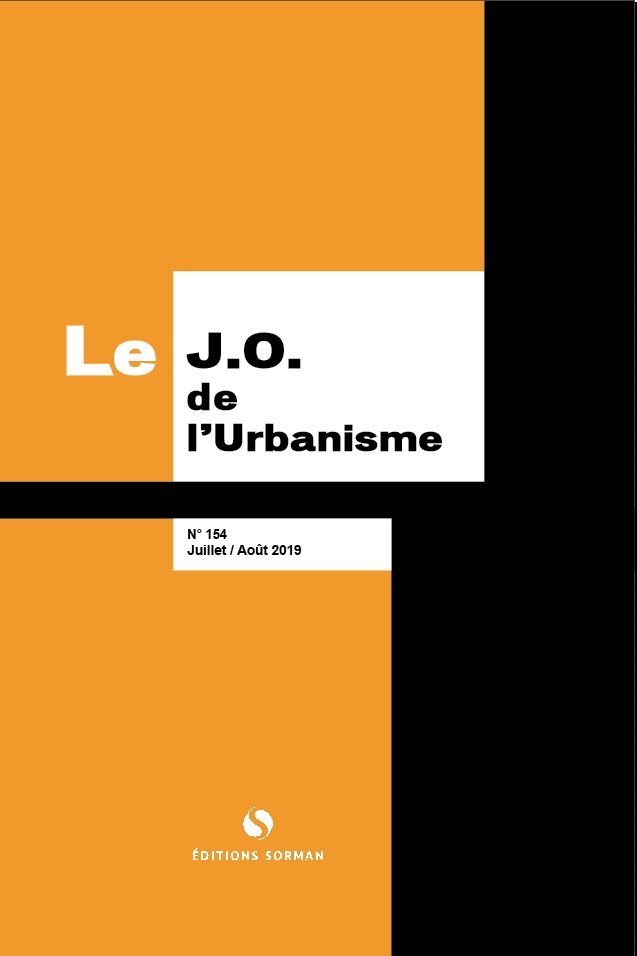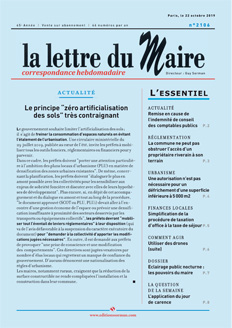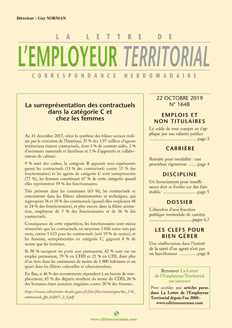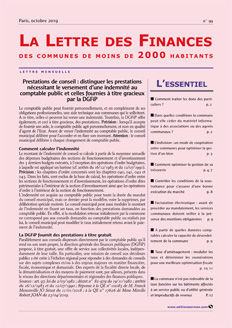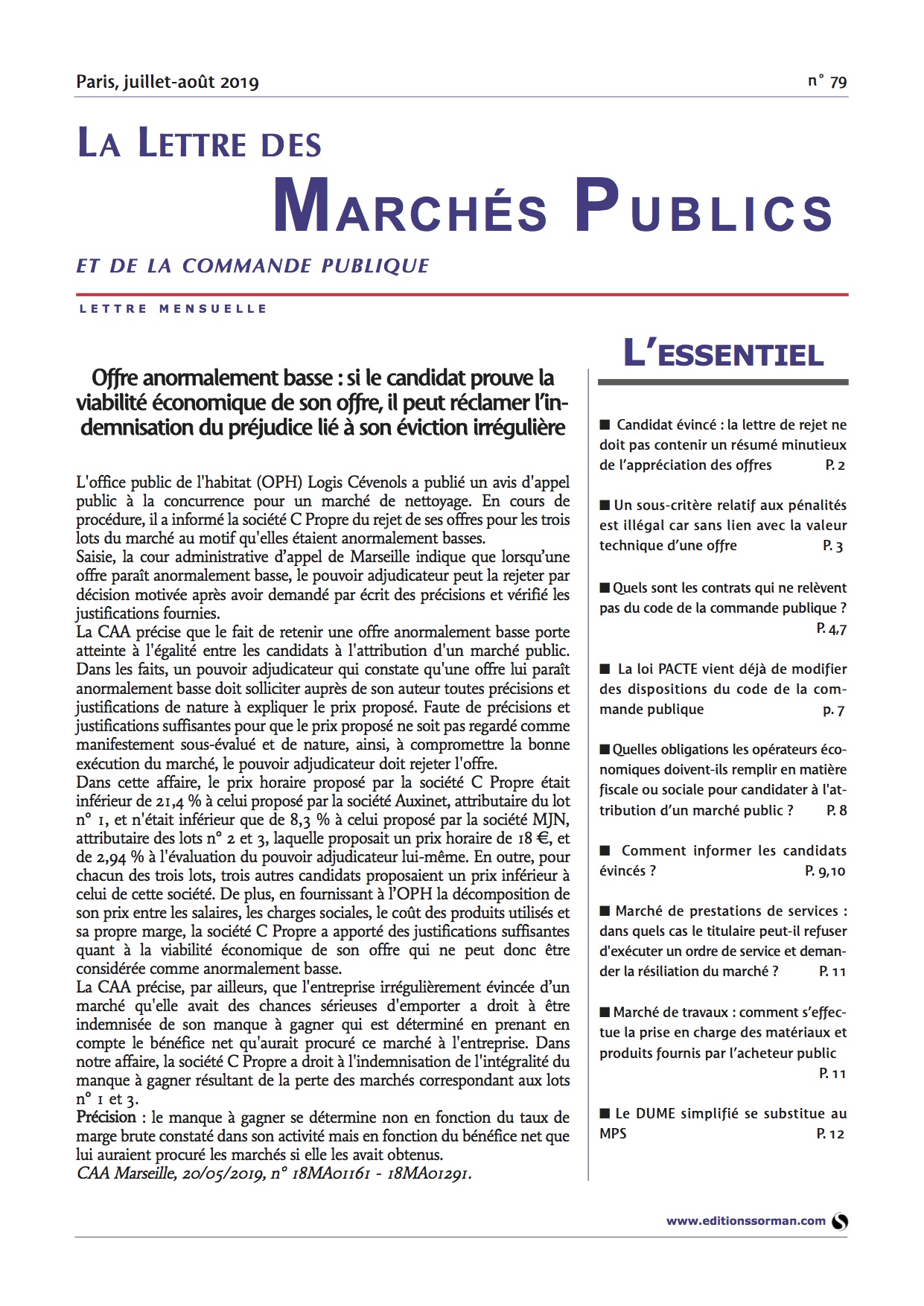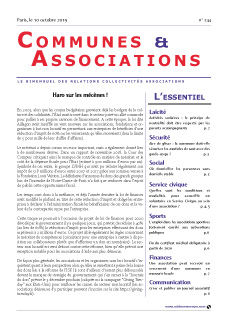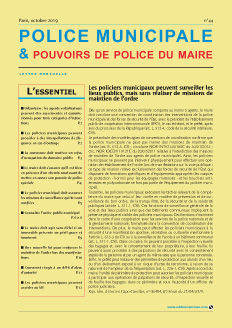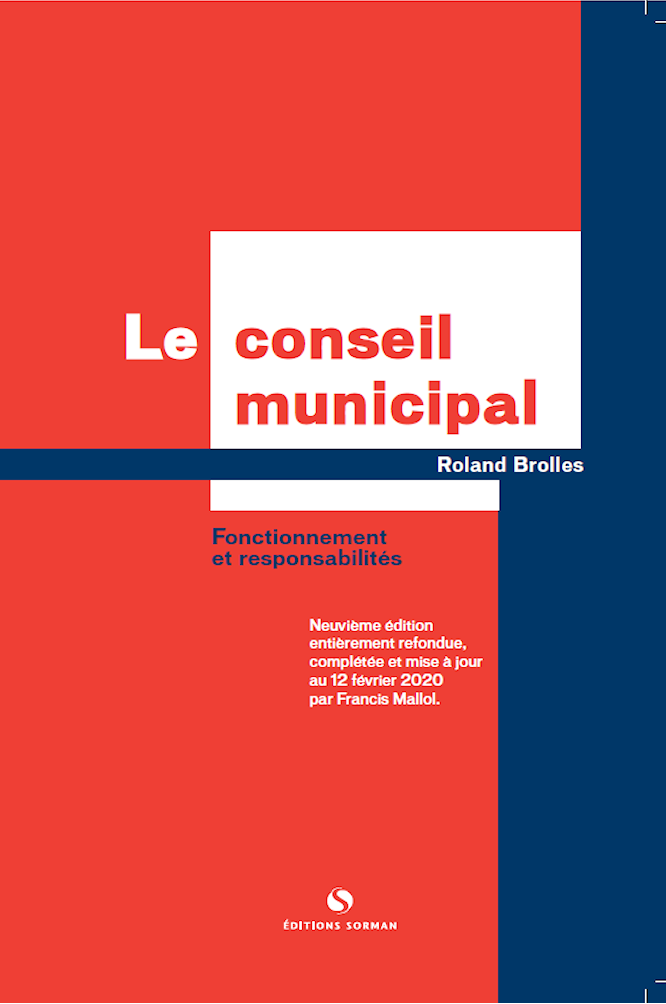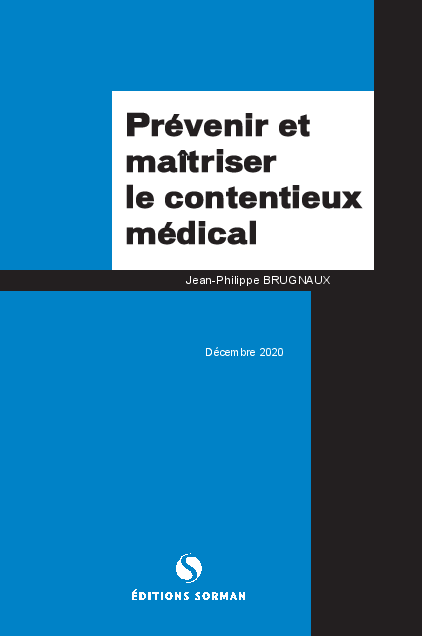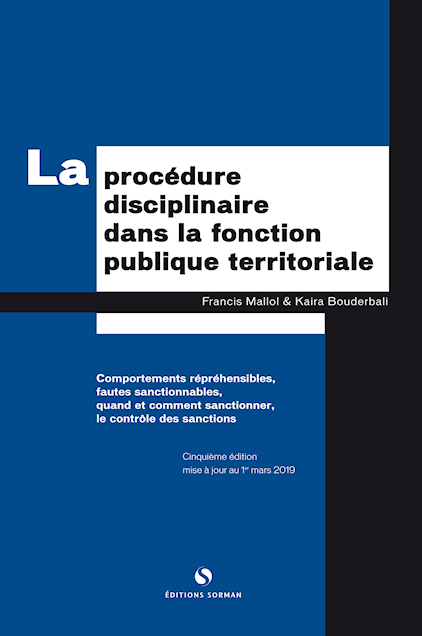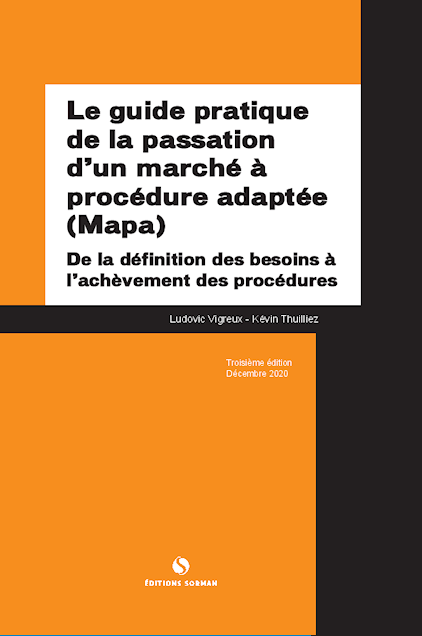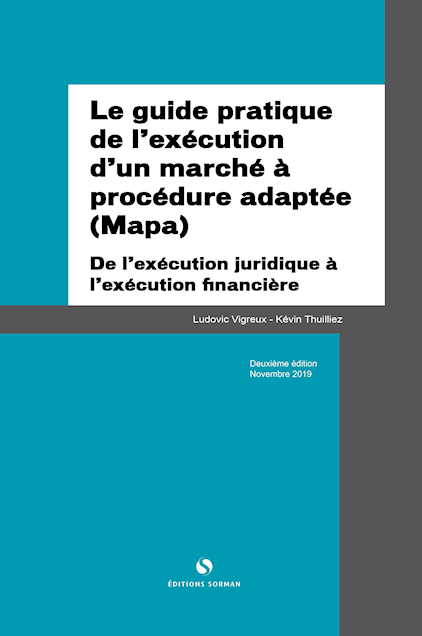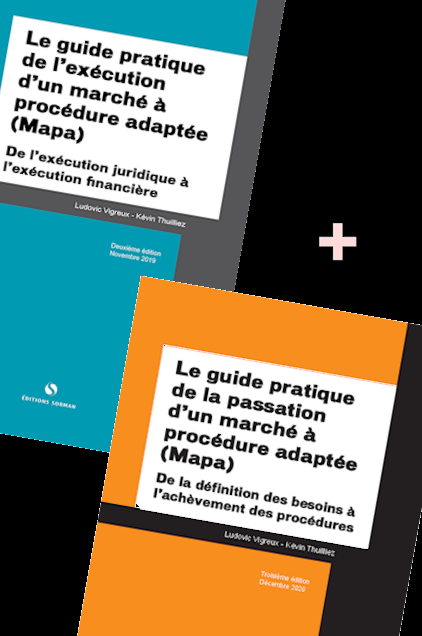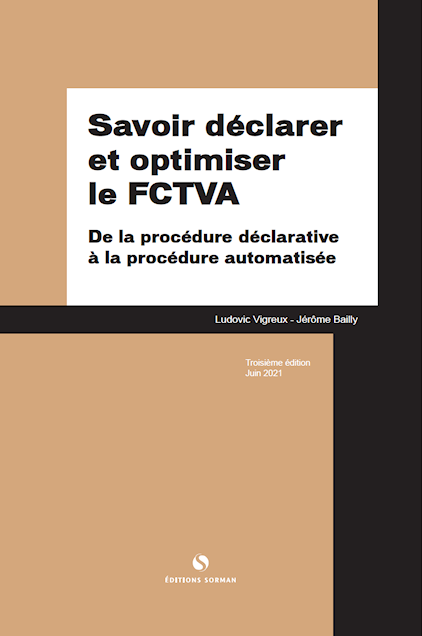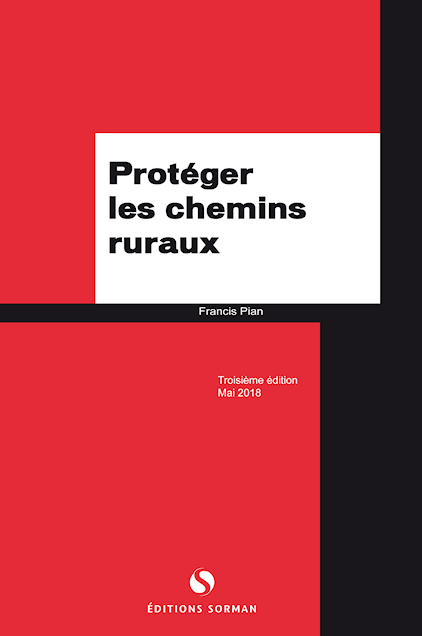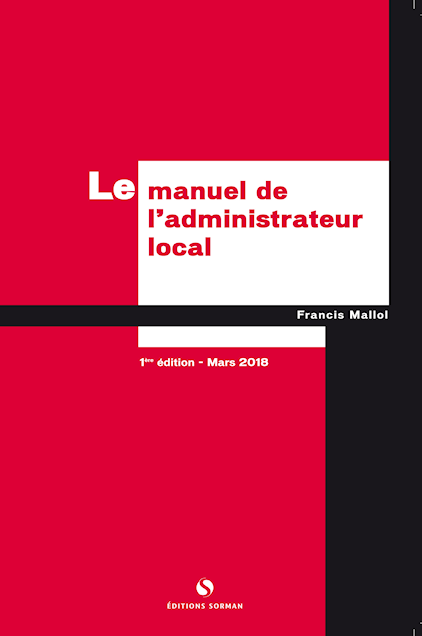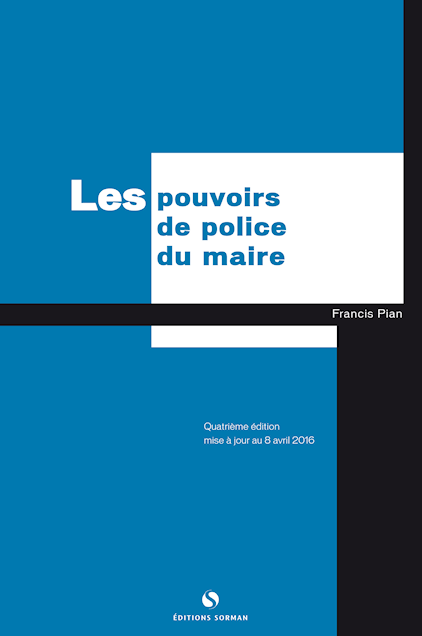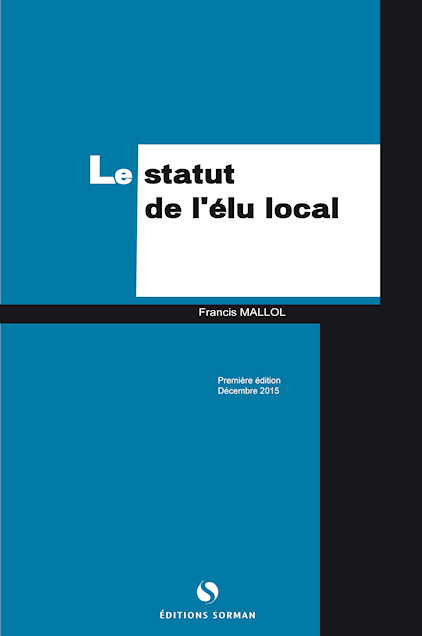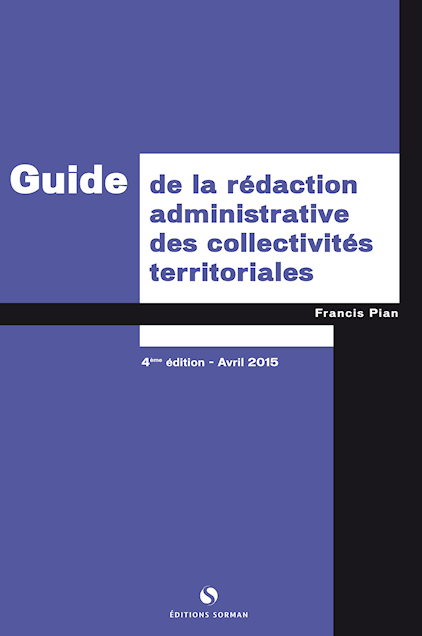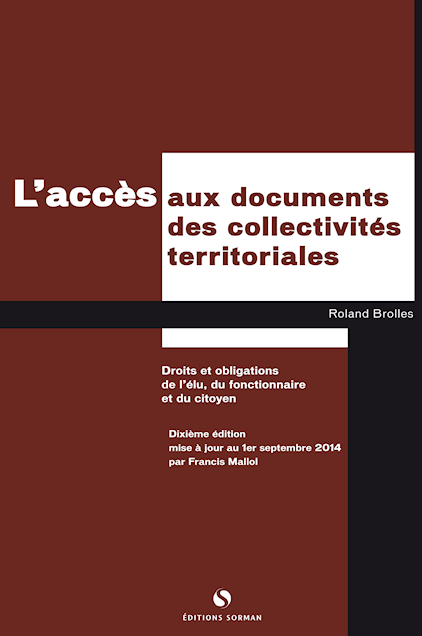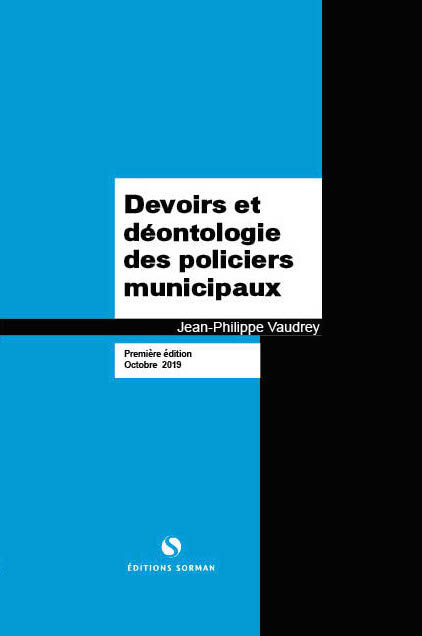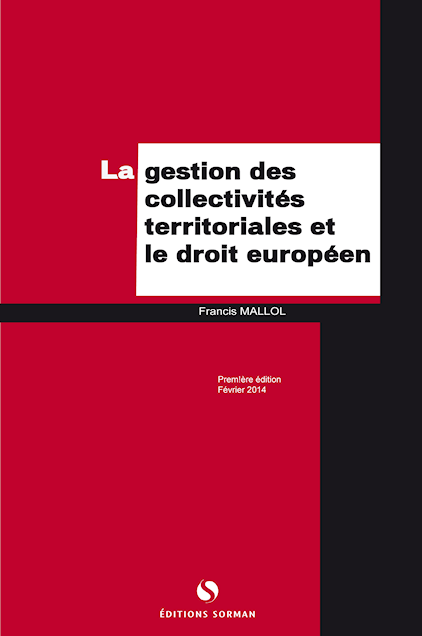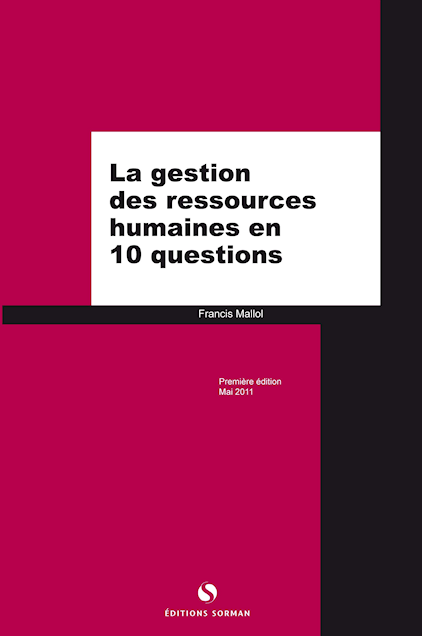Protection de la biodiversité en milieu rural, un nouvel enjeu de coopération locale Abonnés
Une ingénierie au service des villages
Dans ce territoire où la commune centre compte 3 000 habitants et la plus petite 49, l’intercommunalité est un pôle de ressources. Elle conseille les communes sur leur politique d’éclairage public ou de zéro pesticide, sans exercer pourtant aucune des deux compétences. « Nous arrivons à travailler intelligemment avec nos communes pour que les maires s’approprient les thématiques », souligne la responsable du pôle environnement. Elle organise ainsi régulièrement des colloques thématiques (par exemple sur la trame verte et bleue) permettant aux élus de participer à différents ateliers. Le même schéma a été retenu avec les agriculteurs. « Nous avons désamorcé certaines tensions, fait connaître la communauté de communes et la police de l’environnement », se félicite Odeline Dallongeville.
Un réseau de partenaires pour multiplier les moyens
La communauté de communes n’a pas toujours tous les moyens voulus, elle a donc constitué un réseau de partenaires. Par exemple, pour travailler sur la création de mares dans le cadre de sa trame verte et bleue, elle s’est rapprochée du Pays de la Déodatie (qui avait déjà réalisé des études préalables sur le sujet) et du conservatoire des espaces naturels (qui est venu effectuer des études de terrain gratuitement). Le matériel pédagogique a été fourni par une association environnementale et une randonnée ludique a été organisée grâce au soutien de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. « Nous n’avons payé que les travaux », explique la responsable. Même logique pour la réalisation d’un atlas intercommunal de la biodiversité. La CCB2V l’a piloté en régie mais en s’appuyant sur de nombreux partenaires : des associations naturalistes du réseau Odonat, le Conservatoire botanique nationale Alsace-Lorraine, la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères de Lorraine (CPEPESC Lorraine). Elle a également associé les habitants en créant un groupe Facebook pour les inviter à photographier des espèces dans leur jardin. Cette connaissance des espèces, y compris des mousses rares, a ainsi progressé de plus de 600 % et permis de disposer de données fiables pour agir en faveur de la biodiversité.
Des décisions prises en concertation
La communauté de communes ainsi donné la priorité aux haies et aux mares notamment. En mesurant l’état des haies (60 % en état moyen et 40 % en mauvais état), l’intercommunalité a engagé un dialogue sur leur restauration avec les agriculteurs (qui la préfèrent à la plantation de nouvelles haies). De même pour la restauration de la continuité des mares qui a un intérêt écologique mais également de protection des terrains communaux et agricoles en cas d’inondation. Par ailleurs, la CCB2V a pu engager les communes dans la trame noire en leur demandant, par le biais d’une charte, de s’engager sur des horaires d’extinction de l’éclairage public, « pour qu’ils ne soient plus liés aux aléas de prix de l’électricité », indique Odeline Dallongeville. 26 communes ont accepté de prendre une telle délibération après une phase de concertation. La décision ayant d’abord été expliquée en amont aux communes, notamment son fondement sur l’atlas de la biodiversité. Tout le monde y trouve son compte : en mettant cet atlas à la disposition des communes, l’intercommunalité leur épargne une partie du coût des études nécessaires à la préparation ou la révision de leurs documents de planification d’urbanisme, ce qui sera incontournable dans la perspective du ZAN.
Jean-Philippe ARROUET le 12 novembre 2024 - n°514 de La Lettre du Maire Rural
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline